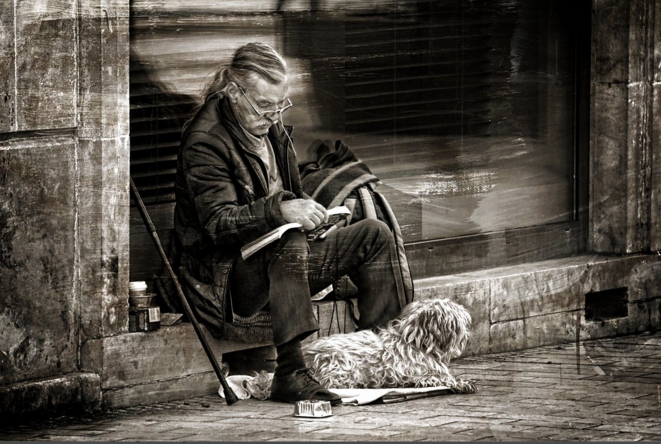Dernier dossier Deep dive de Spectrum News, sur les "thérapies helminthiques", boissons à base de larves de ténia...
Compléments alimentaires, vers et selles : les familles misent sur l'intestin pour traiter des traits autistiques
Les scientifiques font du rattrapage alors que les traitements basés sur le microbiome prolifèrent.
de Leah SHAFFER
26 juin 2019
Toutes les deux semaines, Alex Chinitz avale le plus étrange des breuvages : du jus de fruits mixés avec 20 à 30 larves d'Hymenolepis diminuta. Ce nom latin sophistiqué est en fait le nom d'un helminthe – un ténia, pour être précis – qui peut atteindre 30 cm de long.
Les larves qu'ingère Alex dans sa boisson ne sont pas visibles, il ne sent pas leur goût non plus. Elles sont encapsulées dans de minuscules kystes, et, placées sous un microscope, elles ressemblent à des graines – mais avec des yeux et une queue. Avant d'atteindre la bouche d'Alex, elles sont déjà passées à travers plusieurs autres organismes : les parasites adultes pondent des œufs dans les intestins de rats ; les rats excrètent ces œufs ; les scarabées se nourrissent des excréments de rats ; et à l'intérieur des scarabées, les œufs éclosent sous forme de larves. Une fois qu'Alex les a avalées, les larves nagent dans le lumen intestinal, puis meurent 10 à 14 jours plus tard.
Alex, qui a 25 ans, est autiste non verbal, donc il ne peut pas nous dire ce qu'il pense de cette concoction. Mais sa mère, Judy Chinitz, lui attribue le mérite intégral d'avoir atténué certains traits autistiques chez Alex.
A vrai dire, cette boisson n'est que la toute dernière d'une série de « thérapies helminthiques » qu'elle a essayées. « C'était abordable, et le profil d'effets indésirables est quasi-nul », explique Mme Chinitz. Elle aide à la gestion d'une compagnie au Royaume-Uni, Biome Restoration, qui commercialise les kystes larvaires à des milliers de clients de par le monde. La législation au Royaume-Uni empêche les représentants des entreprises de demander à leurs clients comment ils utilisent le produit. Mais, comme de nombreux forums en ligne l'attestent, de nombreuses personnes recourent à des vers de cette sorte pour traiter des troubles auto-immunes, allergies aiguës, affections de l'appareil digestif – et autisme.
Judy Chinitz en est arrivée à ce traitement inhabituel après avoir passé des années à chercher un soulagement pour son fils. Quand Alex était petit, sa maladie inflammatoire de l'intestin (IBD) chronique était si invalidante qu'il fallait des stéroïdes pour la contrôler ; à un moment, il a pris jusqu'à six médicaments différents. Il s'isolait souvent, et préférait s'asseoir tout seul dans sa balançoire sensorielle plutôt que de rester avec les autres.
L'amélioration de sa santé intestinale est survenue quand il avait environ 10 ans, une fois que sa mère eut modifié son régime alimentaire, en supprimant les céréales et les sucres transformés. Mais elle était curieuse de voir si les helminthes produiraient un effet encore plus important.
Tout d'abord, elle a vu mentionner la « thérapie helminthique » en 1999, dans un article de revue, quand Alex avait 5 ans. « L'article est toujours accroché dans un cadre au-dessus de mon bureau », dit-elle. Mais il lui a fallu des années pour trouver à se procurer des vers. Les helminthes ne sont pas exactement stockés dans les pharmacies, et le fait de les produire, de les distribuer et de les importer est illégal aux Etats-Unis. Pour finir, malgré tout, quand Alex avait 13 ans, elle a trouvé un fournisseur thaïlandais, aujourd'hui appelé Tanawisa. Elle a dépensé 6 000 $ (environ 5 300 euros) pour un approvisionnement de Trichuris suis ova – œufs de trichocéphale qui vivent habituellement dans l'intestin des porcs – et a pris le risque de les faire expédier chez elle à New-York.
Alex a commencé à ingérer dans les 2 500 œufs dans une petite boisson toutes les deux semaines. Environ 14 semaines plus tard, raconte Mme Chinitz, elle a remarqué que son fils n'avait plus envie de rester seul. C'était une sorte de « pilule du bonheur », dit-elle. « Il réagissait si bien que j'ai commencé à paniquer parce que je n'avais pas les moyens de prolonger la cure. » C'est ainsi qu'a commencé leur aventure avec les helminthes.
Malgré sa conviction, il n'existe aucune preuve que ces traitements soient efficaces. Une coloscopie a fait apparaître que l'IBD d'Alex était en rémission, avance sa mère, mais rien ne prouve qu'aucun changement se soit produit dans son cerveau ; quant à son comportement, il s'est peut-être senti plus sociable après avoir ingéré les œufs de tricocéphale pour une raison simple : il avait moins mal à l'estomac. Au moins d'une manière anecdotique, son récit entre en résonance avec de nombreux autres, qui évoquent un soulagement de certains traits autistiques après une thérapie helminthique. Dans une étude de 2017, qui suivait 700 consommateurs d'helminthes, plus de la moitié d'entre eux sont autistes et la majorité a connu une réaction positive, énonce William Parker, chercheur à l'Université Duke à Durham, Caroline du Nord, qui a conduit l'étude. « Les helminthes aident effectivement certains de ces enfants. »
Les partisans de cette approche proposent cela comme un fondement biologique : les traitements qui bousculent l'équilibre des organismes dans l'intestin sont réputés avoir un effet sur le cerveau. Il y a presque 20 ans, par exemple, des chercheurs ont remarqué que les antibiotiques pouvaient engendrer des améliorations passagères chez les enfants autistes qui avaient perdu leurs aptitudes de langage et leurs compétences sociales. Je prends des vers parasitaires pour soigner ma rectocolite hémorragique, une forme d'IBD. Un apport régulier d'ankylostomes semble maintenir la maladie en rémission, mais j'ai essayé auparavant le Trichuris suis sans résultat.
« Peut-être qu'au lieu de [laisser] les gens se débrouiller par leurs propres moyens, nous devrions normaliser cette thérapie, et en rendre l'accès plus équitable et sans danger. » Chiazotam Ekekezie
L'idée de la thérapie helminthique repose grandement sur l'hypothèse des « vieux amis » : durant la plus grande partie de l'histoire de notre évolution, nous, humains, avons partagé nos corps avec une foule de bactéries, de virus et de parasites ; grâce à l'exposition à ces organismes, notre système immunitaire était amorcé et ronronnait de manière continue, comme un instrument bien accordé. Pour l'heure cependant, avec l'hygiène moderne, l'usage répandu des antibiotiques et, dans une certaine mesure, les polluants, nous ne vivons plus avec ce même mélange microbiologique. Ce qui a pour conséquence, du moins c'est ce qu'affirme cette théorie, que notre système immunitaire est susceptible de se détraquer, donnant lieu à des maladies auto-immunes, des allergies, et certaines conditions cérébrales. On ne pense pas traditionnellement à l'autisme comme à une maladie auto-immune, mais nous avons des preuves qu'une dérégulation immunitaire et une inflammation jouent un rôle dans certains cas.
La recherche sur le microbiome – l'ensemble des microbes qui vivent dans le corps et s'y nourrissent – en est encore à ses balbutiements, explique Mauro Costa-Mattioli, professeur de neurosciences au Collège Baylord de Médecine à Houston, au Texas. La seule idée que les microbes puissent influencer le cerveau était « impensable il y a quelques années », ajoute-t-il. Le rythme de la recherche s'est accéléré durant les quelques dernières années, mais les médicaments basés sur les microbes ne sont pas encore en vue.
Malgré cela, nombre de parents et de cliniciens ont décidé de ne pas attendre. Un nombre croissant d'entre eux expérimentent des régimes spécialisés, les probiotiques, la greffe fécale et les parasites, essayant de miser sur l'intestin pour résoudre des traits autistiques centraux. 19 % environ des médecins interrogés dans une étude de 2009 ont affirmé qu'ils conseillaient les probiotiques à leurs patients autistes. Une étude non publiée portant sur 100 personnes a fait état de deux personnes qui essayaient une greffe fécale à domicile pour traiter l'autisme.
Ces thérapies non réglementées peuvent s'avérer coûteuses et imprévisibles – et elles font courir des risques non négligeables, voire mettent en danger la vie des usagers. Les greffes fécales ou parasites à domicile, par exemple, peuvent initier des infections mortelles. Ce mois-ci, la Food and Drug Administration a émis une alerte sanitaire sur les greffes fécales, après que deux bénéficiaires ont contracté une infection résistante aux antibiotiques, et qu’un des deux en est mort.
Etant donné l'intérêt du public pour ces thérapies, les chercheurs devraient « accélérer le processus, jusqu'à explorer et à en comprendre les causes », déclare Chiazotam Ekekezie, qui a dirigé une étude sur 100 personnes, quand elle était résidente médicale en chef à l'Hôpital de Rhodes Island à l'Université Brown. « Peut-être qu'au lieu de [laisser] les gens se débrouiller par leurs propres moyens, nous devrions normaliser cette thérapie, et en rendre l'accès plus équitable et sans danger. »
Le référentiel :
L'intérêt manifesté envers le rôle du microbiome dans l'autisme est légitime : les enfants sur le spectre ont au moins deux fois plus de risques que leurs pairs d'encourir des problèmes digestifs ; ils sont aussi plus susceptibles de connaître des affections de l'estomac, tels la diarrhée et la constipation, qui peut survenir en raison d'un régime alimentaire restreint. De multiples études montrent que les enfants autistes présentent une altération du microbiome, contrairement aux enfants neurotypiques. Cependant, les études sont principalement limitées et non contrôlées – et leur signification n'est pas évidente, dans la mesure où les chercheurs essaient toujours de mettre au point les ingrédients d'un microbiome sain. La recherche n'a pas non plus commencé à préciser si les différences repérées chez les enfants autistes contribuent à leur comportement, ou si au lieu de cela, elles sont la conséquence de leur condition.
Pour apporter une réponse à cette question de la poule et de l'oeuf, des chercheurs se sont tournés vers les animaux modèles. Au cours d'une série d'expériences rapportées cette année, le microbiologiste Sarkis Mazmanian, de l'Institut de Technologie de Californie, avec ses collègues, ont prélevé des excréments d'enfants autistes et de sujets contrôles, et ont injecté les échantillons chez des souris, qui n'ont pas leur propre microbiome. Comparées aux sujets contrôles, les souris qui ont reçu les microbes de personnes autistes ont présenté ce qui pourrait bien être interprété comme des comportements de type autistique : elles vocalisaient moins que les souris contrôles, passaient moins de temps à interagir avec d'autres souris et montraient davantage de comportements répétitifs, comme enterrer des billes.
Ce résultat laisse penser que le microbiome a un effet sur les comportements autistiques, nous dit Mazmanian. Mais le fait d'enterrer des billes chez la souris est tout de même loin d'un trait autistique chez les humains. L'équipe a également analysé les produits chimiques fabriqués par les microbes : ces métabolites constituent une des chaînes de communication entre le cerveau et l'intestin. Dans une étude en 2013, ils ont abouti au résultat qu'un produit chimique en particulier, appelé 4EPS – produit chez les souris aux traits autistiques, selon l'étude mentionnée précédemment, provoque de l'anxiété, mais aucun autre comportement de type autistique. Dans une étude plus récente, deux autres molécules ont semblé favoriser les comportements répétitifs chez les souris, et les rendre moins sociables.
La seconde étude a suscité une abondance de critiques chez les experts, qui ont pointé le fait que le comportement de ces animaux différait d'une manière significative et qu'ils ne réagissaient pas d'une manière systématique. Certaines des souris ayant reçu les excréments « autistiques », par exemple, n'agissaient pas différemment des souris contrôles. D'autres ont fait remarquer de possibles erreurs statistiques dans l'analyse.
Pourtant, Mazmanian affirme que l'étude indique globalement que les métabolites produites par les bactéries peuvent influencer le comportement, du moins chez les souris, et que les données jusqu'à maintenant ne révèlent que la partie émergée de l'iceberg. Il ajoute que ses collègues et lui ont identifié de nombreuses autres métabolites qu'ils n'ont pas encore eu le temps ou les ressources d'examiner. Rien que pour étudier cette métabolite, la 4EPS, cela nous a pris sept ans », conclut-il.
Les mécanismes impliqués dans la communication cerveau-intestin sont nombreux et constituent différentes couches. Le nerf vague, par exemple, relie le tronc cérébral aux organes viscéraux ; des molécules de réception du système immunitaire, comme les hormones ou les neuro-transmetteurs, sont tous à même de moduler des messages envoyés dans un sens ou dans l'autre. Costa-Mattioli s'est concentré sur une seule espère de bactérie intestinale, Lactobacillus Reuteri, que l'on trouve dans les yaourts et les probiotiques du commerce. En 2016, son équipe a démontré que cette bactérie semblait rétablir la sociabilité chez les petits de souris obèses.
Dans une enquête de suivi l'année dernière, l'équipe a testé L. Reuteri chez trois souris modèles élevées sans microbiome. A nouveau la bactérie a rétabli les comportements sociaux des souris – mais seulement à certaines conditions. « Nous avons été très surpris de constater qu'en coupant le nerf vague, la bactérie n'était plus capable d'inverser les déficits sociaux », remarque Costa-Mattioli. Les souris ne réagissaient pas non plus si les chercheurs éliminaient les récepteurs d'ocytocine dans le cerveau. Costa-Mattioli suppose que L. Reuteri fabrique une métabolite qui stimule la production par le nerf vague d'ocytocine, « l'hormone du câlin », hormone qui ensuite active le centre de récompense du cerveau concernant le comportement social. Si l'on bloque le message à n'importe quel point de ce relais – de la bactérie à la métabolite, au nerf vague puis aux récepteurs d'ocytocine - on endommage la sociabilité de l'animal, mais Costa-Mattioli montre que les microbes peuvent aussi produire le même facteur ou métabolite.
Je ne veux pas affirmer que ce soit la seule », nuance-t-il.
De la souris à l'homme :
Même s’il était possible de modifier le comportement social des souris à l’aide d’un seul microbe ou d’un agent microbien – et le « si » est de taille – les gens sont considérablement plus complexes en termes de cerveau, comportement et bactéries intestinales.
C’est pour ces raisons que manipuler l’intestin humain de manière effective s’avère un enjeu sérieux. L’approche la plus directe implique peut-être un régime alimentaire, des suppléments et prébiotiques, les aliments riches en fibres qui nourrissent les bactéries : un essai aléatoire à petite échelle a laissé voir qu’un régime sans gluten, sans caséine, sans soja, en même temps que des suppléments nutritionnels comme les acides gras essentiels, améliore les traits autistiques. Mais trop peu d’études systématiques ont été menées pour prouver qu’un régime puisse avoir un effet avéré sur la condition autistique.
L’objectif de certains cliniciens est de préserver le microbiome par l’introduction de « bonnes » bactéries sous la forme de probiotiques. De nombreux probiotiques sont disponibles sans ordonnance, mais là encore, la littérature scientifique sur ce sujet est mitigée. Des analyses montrent que les probiotiques peuvent améliorer des troubles comme le syndrome de l’intestin irritable, mais peu de recherches font état de leurs résultats sur les traits autistiques.
Les greffes fécales sont une voie plus directe encore. Voyez les probiotiques comme des plantes isolées implantées dans une vaste jungle. Le régime et les suppléments ne font qu’amender le sol ; une greffe fécale revient à remplacer la jungle entière.
Une petite étude ouverte de 2017 a testé des greffes fécales quotidiennes d’enfants typiques chez 18 enfants autistes. « Une des choses les plus étonnantes que nous avons constatées est l’amélioration sur les symptômes gastro-intestinaux, mais également sur le comportement et sur le microbiome à 10 [semaines], mais une grande partie de ces améliorations se sont maintenues et même renforcées à 18 [semaines] », énonce la chercheuse principale Rosa Krajmalnik-Brown, professeure de génie civil et environnemental à l’Université de l’Etat d’Arizona à Tempe. Une étude de suivi en avril a établi qu’une grande partie de ces améliorations avait persisté après deux ans.
Des critiques mettent en exergue le peu d’ampleur et le manque de sujets contrôles dans cette étude, mais Krajmalnik-Brown répond que l’équipe travaille sur une étude aveugle à une plus vaste échelle, dans laquelle la moitié des participants recevront le traitement, et l’autre moitié un placebo. Ils espèrent recruter plus de 80 adultes autistes.
“Les helminthes sont vraiment une grande aide pour certains enfants. » William Parker
La thérapie helminthique est une des plus obscures parmi ces approches qui visent le microbiome. L’idée de l’expérimenter pour l’autisme est née en 2005, avec Lawrence Johnson, un homme autiste qui a maintenant 28 ans ; il était sujet à des explosions d’agressivité et d’auto-mutilation quand il était enfant. Le comportement de Lawrence a brusquement changé un été, à ses 13 ans, alors qu’il participait à un camp d’été pour des enfants à besoins spécifiques. Les conseillers ont appelé son père, Stewart Johnson, pour lui rapporter que le garçon était devenu subitement calme et capable de plus d’interactions.
Quand Stewart Johnson est venu récupérer Lawrence, il a remarqué que les jambes de son fils étaient couvertes de morsures d’aoûtats. « C’était trop fortuit ; il y avait nécessairement une sorte de lien », se rappelle avoir pensé Johnson. Il s’est demandé si ce lien pouvait se rapporter au système immunitaire – le comportement de Lawrence semblait aussi s’améliorer quand il avait de la fièvre, et que son système immunitaire combattait une infection. Pour accréditer davantage cette idée, Lawrence revint à son comportement habituel quand les morsures disparurent, 10 jours plus tard.
Stewart Johnson s’est mis à lire quelques ouvrages et, comme Judy Chinitz, il est tombé sur la thérapie à base de Trichuris suis. Il l’a apporté au médecin de son fils, Eric Hollander, directeur du Programme pour le Spectre de l’Autisme et des Troubles Obsessionnels Compulsifs au Collège de Médecine Albert Einstein à New-York. Hollander a commencé à donner à Lawrence une dose pour trois mois, prescrivant au garçon d’avaler les œufs dans une boisson toutes les deux semaines. Les effets ont été rapides et saisissants, relate Stewart Johnson : « C’était vraiment remarquable ; on revenait à tous les bons effets que nous avions déjà connus. » Le Dr Hollander, lui aussi, se rappelle une nette amélioration concernant l’agressivité de Lawrence, ses auto-mutilations et une ouverture pour changer dans ses routines, ajoutant « qu’il était plus facile pour la famille de voyager avec lui ».
L’année dernière, Hollander et ses collègues ont publié une petite étude sur la thérapie helminthique chez 10 adultes autistes. Pour accroître leurs chances de voir apparaître une réaction, ils ont sélectionné des participants qui avaient une histoire personnelle ou familiale de problèmes d’auto-immunité, comme les allergies. Après 12 semaines de ce traitement, ils ont mesuré l’impact de la thérapie sur certains traits autistiques. Globalement, les participants ont montré moins de comportements répétitifs, de rigidité comportementale et d’irritabilité. La prochaine étape, indique Hollander, sera d’identifier des bio-marqueurs pour catégoriser les groupes de personnes et de traits qui seraient plus susceptibles de réagir à ces thérapies.
Les voies inflammatoires ne jouent pas un rôle chez tous les autistes, nous dit Hollander, mais il se peut que les comportements répétitifs et la rigidité, par exemple, soient particulièrement sensibles aux modifications du microbiome ou du système immunitaire chez certaines personnes. « Il est possible que différentes thérapeutiques puissent être envisagées pour les comportements répétitifs, de même qu’il pourrait y en avoir pour la communication sociale », conclut-il.
Le marché du biome :
Si ces axes de recherche évoluent positivement, les médecins seront peut-être à même un jour de traiter l’autisme en proposant une combinaison de médicaments, certains ciblant le microbiome.
Une pléthore d’entreprises de biotechnologie tentent de concevoir ou de cultiver le parfait mélange de microbes intestinaux ou même de petites molécules qui manipulent les microbes intestinaux, pour des traitements de l’autisme et d’autres troubles. En février, par exemple, la société Axial Biotherapeutics, basée à Boston, co-fondée par Mazmanian, a levé 25 millions de $ dans une deuxième phase de financement pour développer de petites molécules spécifiques pour l’intestin, pour traiter l’autisme et la maladie de Parkinson.
Jusqu’à maintenant, toutefois, les compagnies pharmaceutiques n’ont pas montré un intérêt marqué, peut-être parce que les questions de régulation freinent le recours à ces thérapies. Et même si la Food and Drug Administration a approuvé les greffes fécales, sous surveillance étroite, pour soigner les personnes atteintes d’infections mortelles à cause du Clostridium difficile, il leur reste à statuer sur les excréments dédiés à d’autres usages, comme pour l’IBD. Krajmalnik-Brown et ses collègues ont l’espoir de développer des cocktails microbiens qui pourraient être administrés par voie orale, ce qui pourrait en faciliter l’approvisionnement et la régulation.
Ce défi de la standardisation rend également les helminthes plus difficiles à commercialiser. Les compagnies ont dédaigné les parasites depuis qu’un essai clinique d’œufs de Trichuris suis destiné à soigner la maladie de Crohn, une forme d’IBD, a fait fiasco en 2014. L’entrepreneur en biotechnologie allemand, Detlev Goj, qui était impliqué dans ces essais et a co-fondé la firme thaïlandaise de distribution d’helminthes Tanawisa, s’efforce d’obtenir que les œufs de parasites soient réglementés comme nourriture médicale en Europe. S’il y parvient, les œufs seraient en libre accès dans les supermarchés sur le territoire européen, à côté des boissons aux probiotiques. Pour finir, Goj espère que les œufs d’helminthes seront réglementés comme supplément alimentaire aux Etats-Unis.
Dans l’intervalle, les familles continuent à tâtonner avec les suppléments, les excréments et les vers à domicile, en grande partie par essai et erreur. Si l’on en croit les groupes formés sur facebook et partout ailleurs, certains vers fonctionnent mieux pour certaines personnes, et d’autres ont des effets secondaires, comme des éruptions cutanées, des douleurs sur le corps et des diarrhées. Et puis, il y a aussi le coût des vers et la difficulté d’approvisionnement – sans parler de leur caractère répugnant.
Lawrence Johnson a ingéré des œufs de Trichuris Suis durant sept ans, mais c’était coûteux, et le traitement a perdu en efficacité avec le temps, regrette son père. Alex Chinitz a aussi arrêté de prendre des œufs après cette première ration à cause du coût élevé. Sa mère en achetait un stock les quelques fois où elle pouvait se le permettre.
Entretemps, elle lui a fait essayer un autre ver, Necator americanus. A la différence des larves de Trichuris suis ou de Hymenolepis diminuta, qui passent par l’intestin mais en général n’infectent pas les gens, les larves du parasite N. americanus creusent dans la peau et colonisent l’intersection entre le petit et le gros intestin. Pour se procurer ces vers, Mme Chinitz, ses deux enfants et ses parents se sont tous rendus au Mexique, sous la supervision du médecin d’Alex. Après plusieurs mois, cependant, il a fallu abandonner le traitement d’Alex, qui n’avait pas donné de très bons résultats jusqu’à ce point, car une terrible éruption cutanée était apparue. Finalement, ils ont trouvé l’Hymenolepis diminuta qu’il prend à présent.
Ces jours-ci, Alex a un régime alimentaire normal et les symptômes de son IBD sont en rémission depuis plus de dix ans. Il aime manger dehors, écouter de la musique et voyager, et sa mère le décrit comme « un jeune homme très heureux ». Et toutes les deux semaines, sa boisson spéciale chargée en larves l’attend.
Source :
https://www.spectrumnews.org/features/d ... sm-traits/
Liens :
http://biomerestoration.com/hdc/
https://tanawisa.com/
https://surgery.duke.edu/faculty/william-parker-phd
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10921511
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1774411/
https://www.spectrumnews.org/news/large ... lammation/
https://www.spectrumnews.org/wiki/microbiome/
https://www.bcm.edu/people/view/mauro-c ... 0027880ca6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19280328
https://www.sciencedirect.com/science/a ... via%3Dihub
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biol ... us-adverse
https://www.spectrumnews.org/news/analy ... in-autism/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4054584/
https://www.cell.com/cell-host-microbe/ ... 12)00358-7
https://www.spectrumnews.org/features/m ... or-autism/
https://www.spectrumnews.org/news/gut-m ... vior-mice/
https://www.spectrumnews.org/wiki/repetitive-behavior/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3897394/
https://medium.com/metascience/can-gut- ... 2306fd7235
https://pubpeer.com/publications/B521D3 ... F1ED193ACA
https://www.spectrumnews.org/wiki/neurotransmitters/
https://www.spectrumnews.org/news/singl ... s-in-mice/
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0 ... all%3Dtrue
https://www.spectrumnews.org/news/mouse ... in-autism/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5872787/
https://pediatrics.aappublications.org/ ... 6.abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2709042/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5872787/
http://environmentalbiotechnology.org/k ... brown-lab/
https://www.nature.com/articles/s41598-019-42183-0
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT ... mes&rank=2
http://autismtso.com/about/the_story/
http://www.einstein.yu.edu/faculty/1198 ... hollander/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/302 ... Fab2kftoUs
https://www.spectrumnews.org/wiki/biomarkers/
https://www.axialbiotherapeutics.com/Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Diagnostic d'autisme juillet 2019.